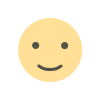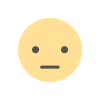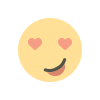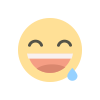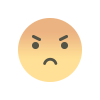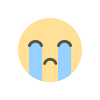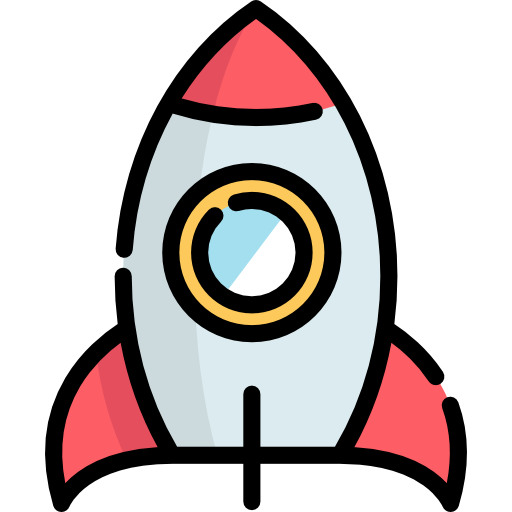Barrage de Nachtigal : répondre aux procès en inutilité
TRIBUNE LIBRE. Par L’Honorable Francis Lin Essono, Député à l’Assemblée Nationale du Cameroun.

Depuis quelques temps, une littérature véhémente circule dans certains médias et sur les réseaux sociaux, présentant le barrage de Nachtigal comme un chantier inabouti, un « éléphant blanc » ou un « fiasco national ». Devant l’insistance de ces narratifs approximatifs, j’ai jugé nécessaire de m’en remettre non aux rumeurs, mais aux faits. C’est ainsi que je me suis rendu sur le site de Nachtigal, afin d’observer par moi-même l’état réel de l’infrastructure et d’échanger longuement avec les ingénieurs et techniciens en charge de son exploitation. Cette immersion m’a édifié : bien loin de l’inopérance fantasmée, la centrale fonctionne, elle produit, et elle contribue chaque jour à la stabilité énergétique du Cameroun.
Il est d’ailleurs essentiel de rappeler un point systématiquement ignoré par les commentateurs : Nachtigal a été conçu sur la base d’un partenariat public-privé (PPP). Ce modèle n’est pourtant pas nouveau au Cameroun. La centrale à gaz de Kribi fonctionne selon le même schéma depuis près de 20 ans, avec un coût d’environ 8 milliards de FCFA par mois pour l’État. À l’inverse, Nachtigal, grâce à sa structuration financière exemplaire — considérée par la Banque mondiale comme la meilleure structuration financière de projet énergétique au monde en 2023 — permet de réduire considérablement les charges globales du système électrique.
Le projet a d’ailleurs nécessité une mobilisation financière d’une rare complexité, tant les montants engagés étaient importants. Autre donnée capitale : Nachtigal vend le kWh à 42 FCFA, contre environ 200 FCFA pour les centrales thermiques. La différence est spectaculaire : avec Nachtigal, le coût du kWh a littéralement fondu, permettant à terme une réduction structurelle du coût de production de l’électricité au Cameroun.
Une mise en service progressive, méthodique et conforme aux standards
Contrairement aux perceptions hâtives, la mise en service du barrage de Nachtigal n’a jamais été chaotique. Elle s’est déroulée de façon progressive entre décembre 2023 et mars 2025, selon un calendrier parfaitement aligné sur les exigences techniques d’un ouvrage hydroélectrique d’une telle envergure. Le premier groupe a été injecté en décembre 2023, les autres s’étant succédé durant 2024. Le 18 mars 2025 constitue un tournant : la mise en service du septième groupe a permis d’atteindre la capacité totale de 420 MW, faisant de Nachtigal la plus grande centrale hydroélectrique du Cameroun et de l’Afrique centrale.
Ce phasage n’est en rien un signe de fragilité. Il correspond à l’orthodoxie des grands barrages : des essais successifs, des validations techniques, et une montée en puissance rigoureusement contrôlée. NHPC, entreprise de projet, l’a d’ailleurs officialisé dans sa communication du 19 mars 2025.
Un barrage pleinement opérationnel : ce que les faits et le terrain confirment
Au terme de ma descente sur le site, un constat s’est imposé avec netteté : Nachtigal est pleinement opérationnel. Les ingénieurs rencontrés ont confirmé ce que les communiqués officiels indiquent déjà : à fin octobre 2025, la centrale affiche un taux de disponibilité proche de 100 %, signe d’une remarquable fiabilité technique. Les sept groupes injectent chaque jour 420 MW sur le Réseau Interconnecté Sud, en particulier aux heures de pointe où ils jouent un rôle de stabilisation essentiel.
Ces performances s’appuient sur une infrastructure de transport robuste : une ligne de 225 kV construite par NHPC, longue de 50 km, opérationnelle depuis juin 2024 et raccordée au poste stratégique de Nyom 2, à l’entrée nord de Yaoundé. Cette ligne préfinancée garantit l’évacuation quotidienne de l’énergie produite vers les acteurs publics en charge du transport et de la distribution.
La SONATREL, gestionnaire du réseau de transport, a également attesté par communiqué que l’énergie de Nachtigal circule sans entrave sur le réseau, et que les productions sont validées mensuellement lors des bilans énergétiques techniques.
Ce que les techniciens m’ont expliqué : les variations de débit, un phénomène naturel… aggravé par les changements climatiques
Les échanges avec les techniciens sur place m’ont permis de comprendre un point déterminant, souvent ignoré des commentateurs : les variations ponctuelles de la production ne résultent d’aucun dysfonctionnement du barrage. Elles proviennent exclusivement :
- des fluctuations naturelles et saisonnières du débit du fleuve Sanaga ;
- de la mauvaise hydrologie observée ces dernières années, elle-même liée aux effets de plus en plus perceptibles du changement climatique, qui modifie la régularité et l’abondance des précipitations dans le bassin versant.
« Plus il y a d’eau, plus la centrale atteint aisément son niveau optimal de 420 MW », m’a expliqué un ingénieur responsable des groupes turbinales. Ces variations sont normales pour tout ouvrage hydroélectrique au fil de l’eau.
Pour y remédier durablement, des barrages de réservoir sont en cours d’installation. Ils permettront de constituer des réserves d’eau capables de compenser les périodes d’étiage et de stabiliser la production. Et au-delà de ceux déjà en réalisation, d’autres réservoirs sont d’ores et déjà envisagés et font l’objet d’études approfondies afin de sécuriser, à long terme, la régularité hydraulique du système Nachtigal.
Les techniciens ont été formels : aucune anomalie technique majeure n’est à signaler sur l’aménagement.
Ce que les critiques omettent : les limites sont en aval, pas à Nachtigal.
Les thèses de l’inopérance souffrent d’une confusion fondamentale : elles attribuent à la centrale des contraintes qui relèvent en réalité du réseau de transport et de distribution. Certaines lignes sont anciennes, d’autres en cours d’achèvement, d’autres encore ont été retardées par des litiges fonciers prolongés — parfois plusieurs années — avec des particuliers installés dans les couloirs de servitude. Ces litiges fonciers, ajoutés aux difficultés persistantes de libération des emprises, ralentissent mécaniquement la finalisation de certaines lignes indispensables à l’évacuation optimale de la puissance de Nachtigal. Pour s’en rendre compte, il suffit de descendre sur le terrain : la réalité physique des contraintes saute immédiatement aux yeux et montre clairement que la centrale n’est pas en cause.
À cela s’ajoute l’épineuse question du déséquilibre financier du secteur : Eneo accumule des impayés auprès des producteurs indépendants ; plusieurs grandes entreprises publiques enregistrent elles aussi des arriérés importants. C’est d’ailleurs ce déséquilibre financier criard qui empêche depuis des années de renforcer et de densifier les réseaux de transport et de distribution, aggravant mécaniquement les contraintes observées en aval.
Il s’agit là de difficultés systémiques, structurelles, mais en aucun cas de défaillances imputables à Nachtigal.
Un impact déjà réel pour les ménages et les entreprises
La mise en service complète de Nachtigal n’est pas seulement une donnée technique : elle influence déjà le quotidien de millions de Camerounais. Les ménages bénéficient d’une amélioration progressive de la disponibilité de l’électricité. Les périodes de délestage, bien que persistantes dans certaines zones, se sont atténuées grâce à l’apport des 420 MW injectés en continu.
Pour les entreprises, les effets sont tangibles : réduction de la dépendance aux groupes électrogènes ; stabilisation des processus de production ; diminution des coûts opérationnels.
Malgré la cessation de service de Globeleq — cessation liée notamment à l’arrêt de plusieurs de ses machines, stoppées faute de paiement par Eneo — les grandes villes continuent d’être alimentées sans rupture majeure, grâce à la puissance issue de Nachtigal. Une seconde ligne de transport destinée à renforcer l’approvisionnement de Douala est d’ailleurs en construction.
Une infrastructure structurante pour l’avenir énergétique du Cameroun
Avec un investissement de 786 milliards de FCFA, Nachtigal augmente de 30 % les capacités installées du pays et renforce la part de l’hydroélectricité dans le mix national. Elle permet de réduire les dépenses liées aux combustibles thermiques et positionnera le Cameroun comme fournisseur régional d’énergie, notamment dans le cadre du projet d’interconnexion PIRECT qui prévoit l’exportation de 100 MW vers le Tchad dès 2027.
Sortir des procès d’intention, revenir aux faits
À la lumière des données techniques, des communiqués officiels, mais surtout des constats directs effectués sur le terrain, une conclusion s’impose : le barrage de Nachtigal fonctionne. Il produit. Il injecte ses 420 MW. Il stabilise le réseau. Il soutient les ménages et les entreprises. Il prépare l’avenir énergétique du Cameroun.
Les difficultés subsistantes dans le secteur relèvent du transport, de la distribution et du déséquilibre financier, non de l’ouvrage hydroélectrique lui-même.
Accuser Nachtigal d’inopérance revient à substituer la rumeur à la rigueur, l’apparence au réel, et l’approximation à l’évidence technique.