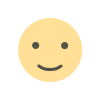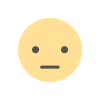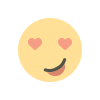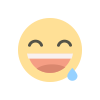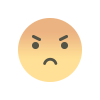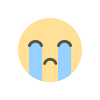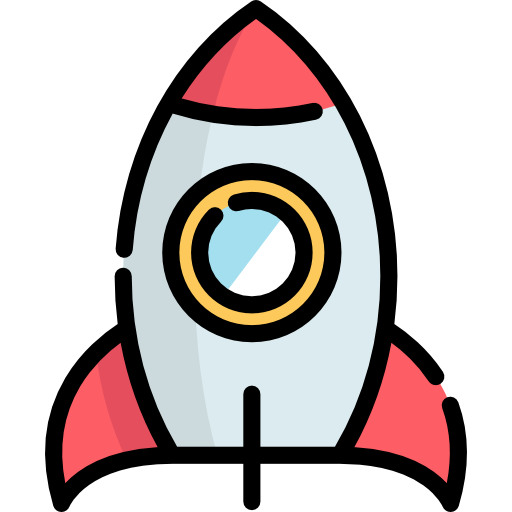Le 7 février 2025, une crise majeure a éclaté dans le département du Mayo Kani, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, suite à une forte mobilisation des populations Toupouri contre la création du parc Ma MBED MBED. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, armés de flèches, machettes et gourdins, sont venus de plusieurs villages, y compris du Tchad voisin, pour manifester leur opposition.
À K
ourbi et
Guidiguis, les manifestants ont bloqué la Route Nationale n°12 dès 4h du matin et ont séquestré le Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, le Préfet du Mayo Kani, le Sous-préfet de Kaélé et leurs états-majors respectifs dans un enclos improvisé en épines. Leur revendication était claire : obtenir sur place la signature d’un décret annulant la création du
parc Ma MBED MBED.
Face à la gravité de la situation, les forces de sécurité, notamment le GMI N°10 et le BIR, sont intervenues avec usage de gaz lacrymogène pour extirper les autorités séquestrées. Un repli tactique a été opéré vers la base du BIR à Kaélé, avant qu’une descente mixte du BIR et du 41e Bataillon d’Infanterie Motorisée (BA) ne soit ordonnée pour sécuriser le tronçon routier Kaélé-Guidiguis et rétablir la circulation. La situation a été suivie de près par les autorités et s’est progressivement stabilisée.
Cet épisode met en lumière les failles profondes de la gouvernance territoriale au Cameroun, notamment l'incapacité d'anticipation des crises marquée par l’absence de concertation et d’inclusivité dans la prise de décisions affectant directement les populations locales.
La mise en place d’une réserve naturelle dans une région où les communautés vivent depuis des générations aurait nécessité un dialogue préalable approfondi, impliquant non seulement l’administration centrale, mais aussi les chefs traditionnels, les élus locaux et les représentants communautaires.
En imposant cette décision sans explication ni concertation, l’État a non seulement suscité un rejet massif, mais a également nourri un sentiment de marginalisation et d’injustice parmi les populations concernées.
Cette crise révèle également la sensibilité extrême des questions foncières et environnementales dans un contexte où les tensions communautaires, les pressions démographiques et les revendications identitaires sont déjà des défis majeurs.
Le fait que des manifestants soient venus du Tchad voisin démontre aussi que cette problématique dépasse les frontières camerounaises et touche des populations transfrontalières qui partagent un même mode de vie et une même histoire. Ce type de situation, mal gérée, peut exacerber des tensions intercommunautaires et fragiliser davantage la stabilité régionale.
D’un point de vue sécuritaire, l’intervention des forces de l’ordre a permis de désamorcer une crise qui aurait pu dégénérer en affrontements violents.
Toutefois, l’usage de la force ne saurait être une réponse durable à des revendications légitimes. Le recours aux unités d’élite comme le BIR pour une crise d’ordre social illustre le manque de mécanismes de dialogue et de gestion pacifique des conflits territoriaux.
Une approche plus anticipative et diplomatique aurait pu éviter une telle escalade et limiter les risques de radicalisation de la contestation.
Pour éviter que de telles crises ne se reproduisent, il est impératif que l’État revoie son approche de la gouvernance territoriale en adoptant une politique plus participative et inclusive.
L’instauration de cadres de concertation réguliers avec les communautés locales, la mise en place de mécanismes de médiation préventive et une meilleure communication sur les enjeux des décisions gouvernementales sont essentielles.
Une gouvernance territoriale efficace repose sur la capacité à équilibrer les impératifs de développement national avec les besoins et aspirations des populations locales.
Enfin, dans un contexte politique déjà chargé d’émotions et de tensions, la gestion de cette crise doit être exemplaire pour éviter d’alimenter un climat de défiance entre l’État et ses citoyens.
Une reconnaissance des erreurs commises dans la mise en œuvre de ce projet et l’ouverture d’un dialogue sincère avec les représentants Toupouri pourraient être des premières étapes vers une résolution durable du conflit.
La stabilité et la cohésion sociale au Cameroun dépendent en grande partie de la capacité des dirigeants à écouter, à comprendre et à intégrer les préoccupations des populations locales dans la gouvernance nationale.
Dr Edouard Epiphane yogo