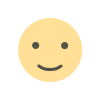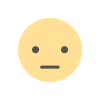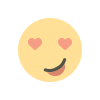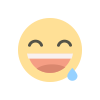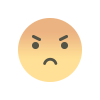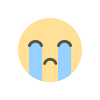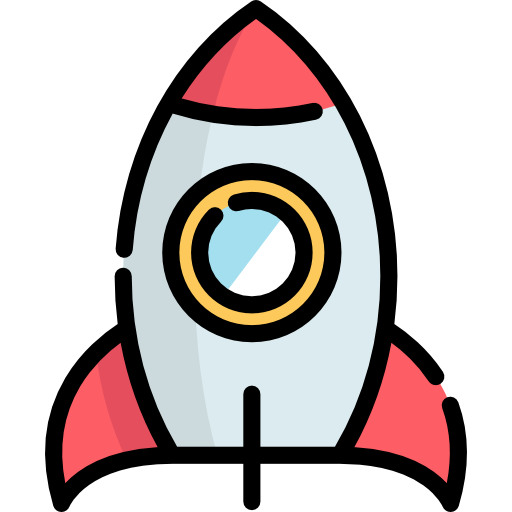CFA : quand on emprunte des signes, on rembourse en ressources
Les États de la zone franc (UEMOA et CEMAC) portent une dette lourde, contractée en devises qu’ils ne contrôlent pas et adossée à des économies dont les recettes d’exportation sont, pour l’essentiel, des matières premières. Ce déséquilibre – « on reçoit de la monnaie scripturale, on rend du pétrole, de l’or ou du cacao » – n’est pas un slogan : c’est un mécanisme documenté. La séquence ouverte par les sanctions contre la Russie l’a révélé sans détour : le dollar et l’euro ne sont pas des actifs « neutres », mais des instruments géopolitiques.

1) Un fait têtu : l’endettement est élevé et le service explose
Dans l’UEMOA, la banque centrale anticipe un ratio d’endettement public autour de 61,4 % du PIB en 2024. Dans la CEMAC, l’encours agrégé est proche de 47 % du PIB, mais l’effort de remboursement devient étouffant : le service de la dette a absorbé près de la moitié des recettes budgétaires en 2024 dans la région, selon le FMI.
Au-delà des stocks, c’est la dynamique qui inquiète : la BEAC observe qu’en 2024, le ratio service de la dette/recettes s’est détérioré, tandis que des incidents de paiement sont apparus sur le marché des titres publics, preuve d’une vulnérabilité accrue au renchérissement mondial du crédit.
2) Une dette en monnaies étrangères… dans un système monétaire contraint
La très grande majorité de la dette publique extérieure des pays CFA est libellée en devises (euro, dollar). Exemple emblématique : la Côte d’Ivoire indique que « la part importante de la dette extérieure est libellée en EUR », ce qui expose directement les finances publiques aux cycles monétaires des pays émetteurs.
Côté architecture monétaire, l’arrimage fixe à l’euro (1 € = 655,957 F CFA) demeure. Depuis la réforme de 2019, l’UEMOA a certes clos son « compte d’opérations » au Trésor français, mais la garantie française subsiste ; en CEMAC, le compte d’opérations est toujours en vigueur et rémunéré, avec des règles de centralisation des réserves qui encadrent la politique monétaire régionale. Autrement dit : la base monétaire et l’accès aux devises restent, en dernière analyse, subordonnés à des accords où la souveraineté est partagée.
3) « Fausse monnaie » vs « biens réels » : ce que disent les contrats
Parler de « fausse monnaie » est une formulation militante, mais une réalité l’alimente : les États CFA s’endettent en signes monétaires créés ex nihilo par des banques centrales étrangères, tandis que leur capacité de remboursement dépend de flux réels – pétrole, minerais, cacao, bois. Cela devient explicite dans les prêts adossés aux ressources (resource-backed loans), où la garantie (et parfois le remboursement) est directement grevée sur le baril ou la cargaison. La Banque mondiale a recensé au moins 30 prêts de ce type en Afrique entre 2004 et 2018 (Angola, Tchad, Congo, Ghana, Guinée, Niger, etc.).
Cas d’école : le Tchad et le prêt Glencore, dont la renégociation a conditionné l’accès à l’aide du FMI ; l’essentiel des revenus pétroliers partait au service de la dette commerciale. Autre exemple : la République du Congo, où des préfinancements adossés au pétrole ont pesé sur la trajectoire de soutenabilité et nécessité un programme FMI. L’avertissement est désormais public : le président de la BAD a appelé à mettre fin à ces montages opaques qui « vampirisent » la souveraineté budgétaire.
4) La preuve par la Russie : le dollar et l’euro sont « armés »
En 2022, environ 300 milliards de dollars d’avoirs de la Banque de Russie ont été gelés par une coalition G7/UE. Depuis, l’UE prélève les intérêts générés par ces avoirs via Euroclear pour financer l’Ukraine, et débat toujours d’une confiscation plus large. Cela démontre que les réserves en devises « fortes » sont exposées à des décisions politiques.
La Russie a aussi obligé, au printemps 2022, les acheteurs européens à régler le gaz en roubles via un mécanisme de double compte, rappelant qu’un pays producteur peut retourner la contrainte : « vous avez l’argent, nous avons l’énergie ».
Les institutions internationales enregistrent le mouvement : hausse des achats d’or par des banques centrales pour se protéger du risque de sanctions, débats sur la fragmentation financière et la « weaponisation » des devises.
5) Le piège des économies « mono-export » : quand on rend plus qu’on a reçu
Dans l’UEMOA, cacao (Côte d’Ivoire), or (Mali), coton (Burkina) financent structurellement la balance des paiements ; dans la CEMAC, pétrole (Gabon, Congo, Guinée équatoriale) et bois dominent. Ainsi, l’or représentait environ 75 % des exportations du Mali en 2023, tandis que le pétrole compte pour plus des deux tiers des exportations gabonaises. Quand les cours baissent, la capacité de service de la dette s’évapore.
Même en cas de hausse de prix (ex. cacao), la transmission au producteur local est limitée par les mécanismes de prix administrés et les contraintes d’offre ; autrement dit, l’État ne capte pas mécaniquement un surplus susceptible d’alléger sa contrainte budgétaire.
6) Ce que cela implique pour les pays CFA
Constat : recevoir des « unités de compte » externes et rembourser avec des recettes tirées de biens réels crée une asymétrie structurante. Les réserves et la politique monétaire sont encadrées par des accords extérieurs ; la dette est majoritairement en devises ; les exportations sont volatiles et concentrées. Dans ces conditions, parler de « fausse monnaie » est une façon de nommer une réalité juridique et géopolitique : le pouvoir d’émission et de sanction n’est pas local, la valeur ultime se trouve dans le sous-sol et les plantations.
7) Sortir du piège : des pistes concrètes (testées et mesurables)
1) Réduire l’exposition aux prêts adossés aux ressources (audit, publication intégrale des contrats, clauses de renégociation automatique). C’est la recommandation convergente de la Banque mondiale, du FMI et de la BAD.
2) Allonger la maturité et « localiser » une part de la dette via les marchés régionaux en monnaie locale, pour limiter le risque de change et de refinancement procyclique. (Les documents FMI/BEAC montrent déjà une montée de l’émission domestique en 2024.)
3) Capturer plus de valeur locale : raffinage et transformation (ex. or et cacao) pour détacher une partie des recettes d’exportation de la seule vente de matières brutes, stabiliser la base fiscale et les réserves. (Des initiatives récentes au Ghana illustrent la stratégie de montée en réserve et en raffinerie.)
4) Diversifier les actifs de réserve (or, paniers multidevises) et les modalités de règlement (accords bilatéraux, plateformes régionales), en intégrant le risque géopolitique sur USD/EUR mis en lumière par le gel des avoirs russes.
5) Instituer des règles budgétaires pro-stabilisatrices liées aux termes de l’échange (fonds de stabilisation des recettes extractives, plafonds de dépenses), pour casser le cycle « hausse – endettement – chute – crise ». Les rapports FMI/BEAC sur 2024-2025 montrent à quel point la dépendance aux prix du pétrole reste le talon d’Achille de la CEMAC.
Conclusion
Le cœur du problème n’est pas moral, il est systémique : quand la création monétaire est ailleurs et que la richesse provient de ressources exportées sous forme brute, l’endettement en devises devient une ponction sur des biens réels. L’épisode russe a mis fin à l’illusion de neutralité des grandes monnaies ; aux pays CFA d’en tirer les conséquences : transparence contractuelle, « localisation » de la dette, montée en gamme productive, et stratégie de réserves qui traite l’argent comme ce qu’il est… un instrument de pouvoir.
Signé : Charly Kengne — Yaoundé, 17 August 2025
Sources (sélection)
• BCEAO – Rapport sur la politique monétaire (déc. 2024). Données UEMOA, dette/PIB.
• FMI (CEMAC) – Staff Report (mars 2025). Service de la dette/recettes et vulnérabilités régionales.
• Banque de France / Sénat français – Réforme 2019 (UEMOA), fin du compte d’opérations BCEAO, maintien de la garantie.
• BEAC – Rapport spécial contrôle du Compte d’Opérations 2022 (CEMAC). Compte d’opérations toujours actif.
• Banque mondiale – Resource-Backed Loans in Sub-Saharan Africa (2022). Cartographie des prêts adossés aux ressources.
• Reuters / Verfassungsblog – Gel d’environ 300 Mds $ d’actifs russes ; débats sur l’utilisation des intérêts.
• Le Monde – Décret « gaz contre roubles » et mécanisme de double compte (mai 2022).
• FMI / Coface – Dépendance matières premières (Gabon : > 2/3 des exportations ; Mali : or ≈ 75 % des exportations).
• BAD / AP – Mise en garde d’A. Adesina contre les prêts adossés aux ressources.